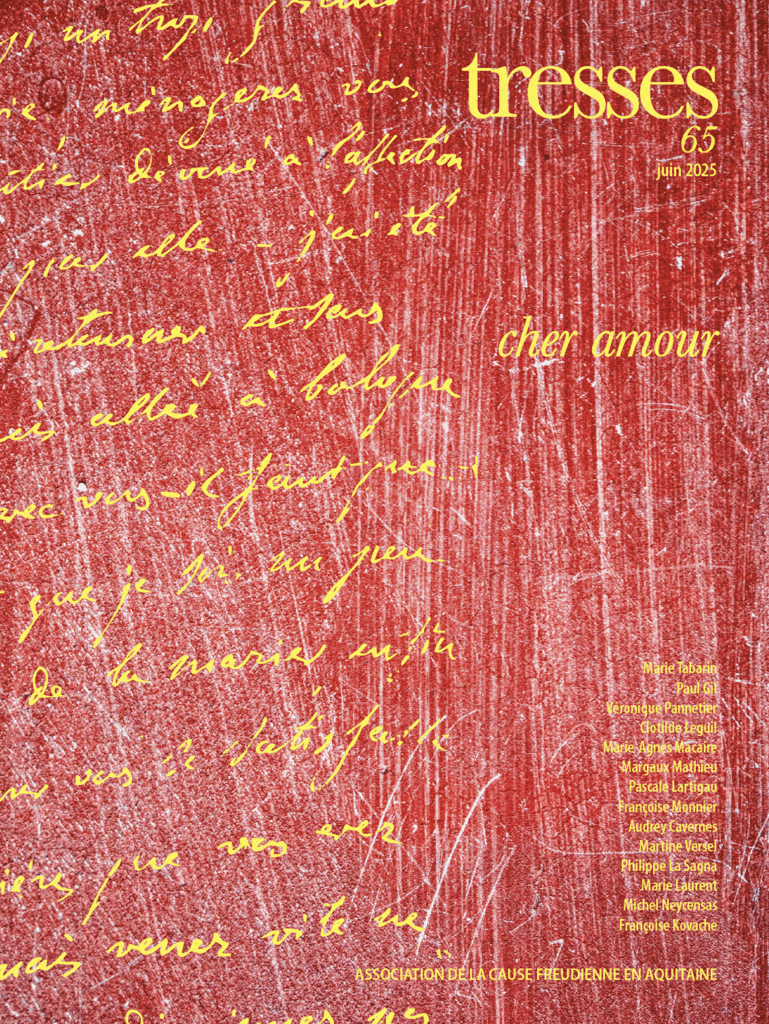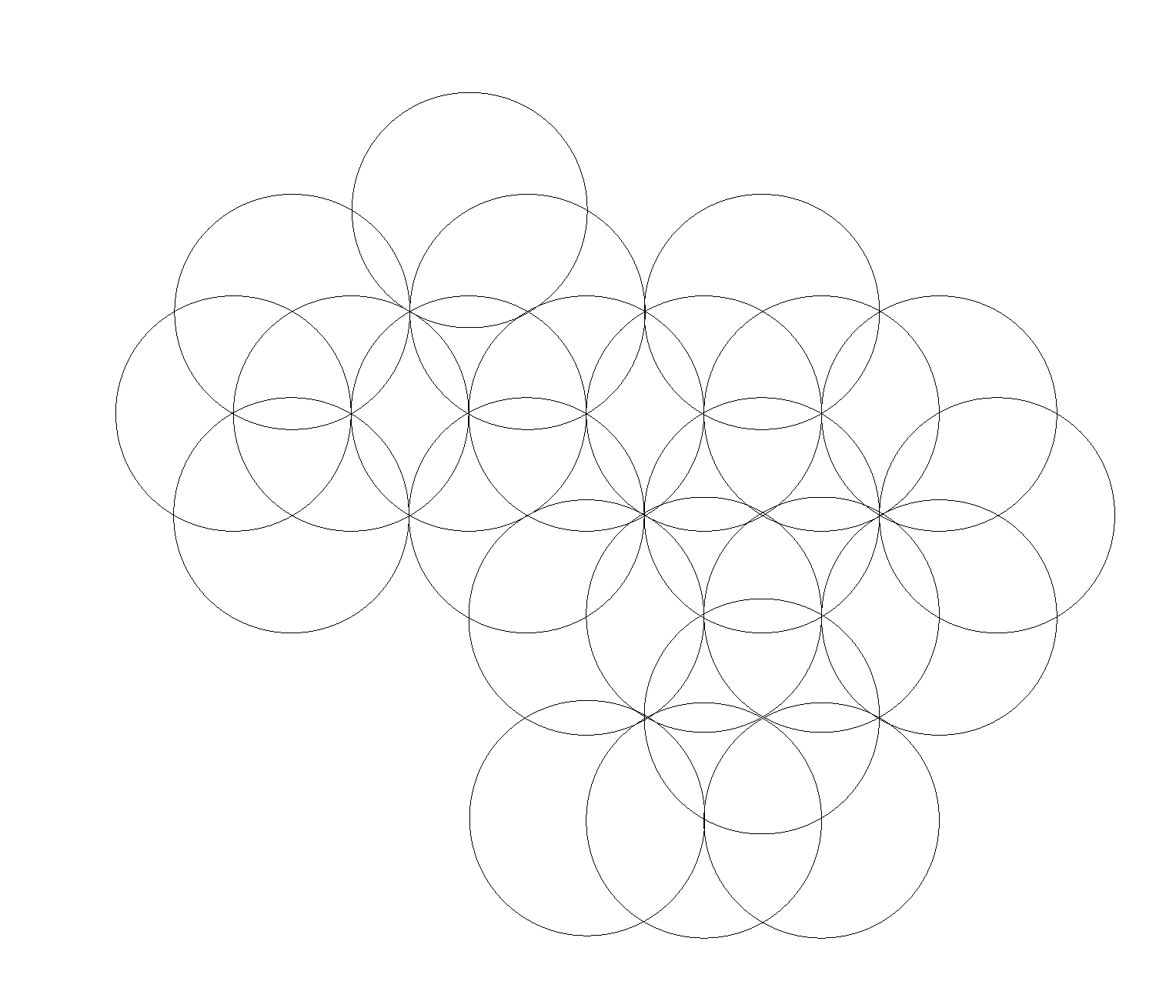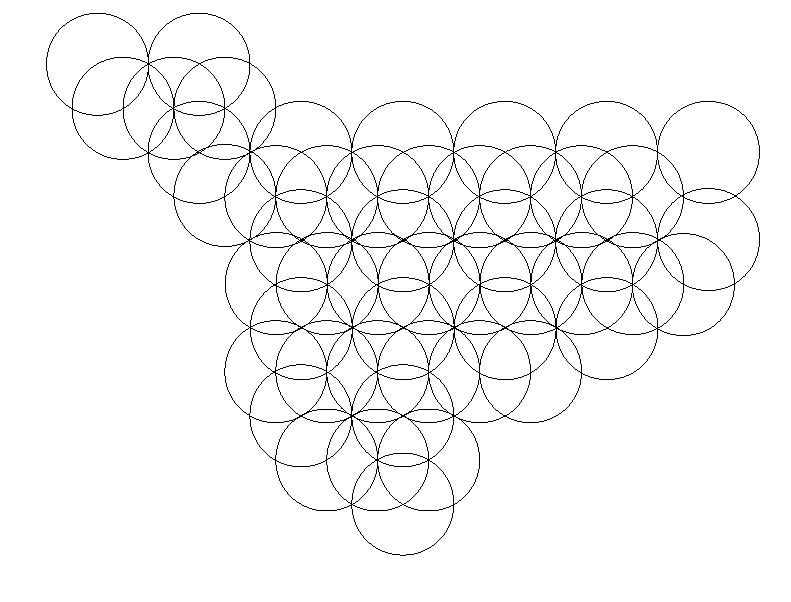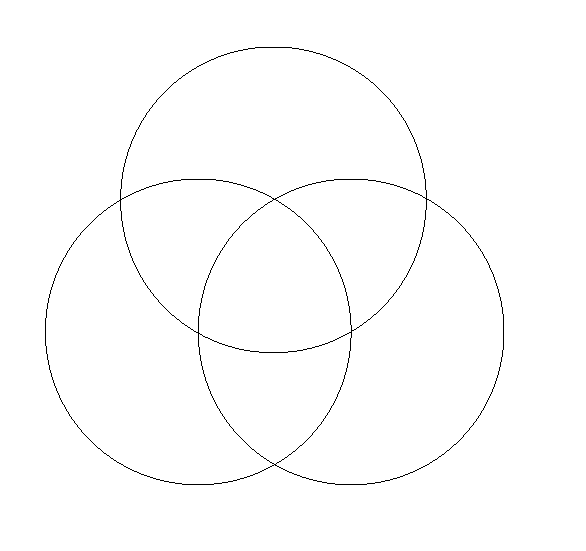Point d’orgue
Chérir l’amour, aimer l’amour, se désespérer de l’amour, que ce soit trop ou pas assez, l’amour reste souvent la cause ou une cause pour commencer une analyse.
La découverte de Freud, c’est l’amour de transfert, un véritable amour. Surprise donc, car en analyse il n’y a pas de corps sexué en acte. « Faire l’amour » ne serait donc pas un vrai amour. C’est ainsi que Lacan peut énoncer que l’âmour c’est l’âme, et que l’âme âme l’âme.[1]
L’amour de transfert supporte le désir du parlêtre. Pourquoi les analysants sont-ils si vivants, si engagés, si opiniâtres ? Prêts à tout, mais pas jusqu’au ravage. Le ravage est de l’ordre de la jouissance. « L’amour c’est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. »[2] Le désir, disait aussi Lacan, est le meilleur remède à l’angoisse.
La littérature abonde d’histoires de ravages, d’amours toxiques, de « mourir d’amour ».. !
Ce numéro 65 de Tresses, recueille cette disparité. Le thème choisi pousse à écrire. Des paradoxes de l’amour présents dans la première partie, on passe aux divers échos de l’amour dans la littérature, sans oublier la vie de l’ACF, et pour finir les ondes nous ont poussé vers l’art, des artistes qui nous touchent par leurs inventions singulières.
Entre répétition et tuche chaque rencontre reste unique entre s’écrire et ne pas s’écrire. « Tout amour, précise Lacan, de ne subsister que du cesse de ne pas s’écrire, tend à faire passer la négation au ne cesse pas de s’écrire, ne cesse pas, ne cessera pas. »[3]
Chacun auteur reste guidé dans son travail d’écriture par l’étude et la pratique de la psychanalyse lacanienne, dont l’axe principal se lit entre les lignes à savoir que l’amour est une élucubration de langage sur l’inexistence du rapport sexuel.
MA Macaire
[1] Lacan J. Le Séminaire, livre XX Encore, texte établi par J.-A. Miller, Seuil, 1975, p.78
[2] Lacan J. Le Séminaire, livre X, L’angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Seuil, 2004, p. 209
[3] Lacan J. Le Séminaire, livre XX, op cité, p. 132.